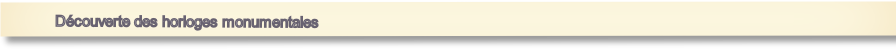


Choose your
language
Villars-le-Sec - Eglise
(Territoire de Belfort - France)
Patrimoine-Horloge © Politique de confidentialité ; Conditions d’utilisation
.jpg)
La commune est administrativement rattachée au canton de Beaucourt.
Histoire : Selon les plaisantins, Villars-le-Sec doit son nom au fait qu'il serait le village français le plus éloigné de toute côte. Le village est situé dans le sud du département, entre Saint-Dizier-l'Évêque et la frontière suisse.
Il porte bien son nom, l'eau étant rare sur ce plateau calcaire à 550 mètres d'altitude. En 1803 il abritait 140 habitants. Ils étaient 123 en 1999.
La première mention de la localité dans les archives date de 1282, sous le nom de Ueler. Villars-le-Sec a fait partie de la paroisse de Saint-Dizier-l'Évêque jusqu'en 1698 avant d'être rattaché à celle de Bure en Suisse.
En 1829 est construire l'église, dédiée à la Nativité-de-la-Vierge et le village devient une paroisse indépendante.
Une croix est plantée à proximité pour rappeler au passant que le lieu est sacré. Autrefois le pèlerin avait coutume de prélever sur cette croix un copeau qui lui portait bonheur pour le reste de son voyage.
Source: Wikipédia
L'église de la Nativité-de-Notre-Dame (1829)
L’horloge
Entièrement faite main dans du laiton, cette horloge était à l’abandon depuis 90 ans.
On peut la voir au musée Jappy de Beaucourt depuis2010.
La restauration
Nous avons descendu l’horloge à l’aide d’un palan, de cordes et de sangles, étage par étage. Après être sortis de l’église, le soleil a éclairé l’horloge, et je me suis aperçu qu’elle était verte. J’ai alors compris de quel métal était constitué ce mécanisme et pris toute la mesure de sa valeur. Jusqu'à sa présentation lors de l’exposition au public, je n’en ai parlé qu’au maire de la commune et au conservateur en chef des musées de Belfort. Toute l’horloge, soit 80 kg environ, est en laiton, mis à part les axes, leviers de transfert et tige du balancier.
La rénovation fut longue, les écrous rouillés bloquaient après quatre vingt dix ans d’humidité. Il a fallu beaucoup d’énergie pour débarrasser l’horloge de la couche d’oxyde qui la recouvrait et atténuer les profondes rayures.
Le mystère de l’horloge de Villars le sec
L’église fut construite en 1829, et quatre cadrans y étaient prévus. Elle a été probablement dotée d’une horloge en fer. Quatre trous creusés au travers des murs de chaque face, pour le passage des tiges aux centres des cadrans, suggèrent cette idée.
Le mécanisme en laiton, la finesse de la construction, empêchaient que l’horloge puisse alimenter plusieurs cadrans. En effet, la sortie de l’axe des heures ne fait que cinq millimètres au carré, les axes des tambours n’auraient pas supporté les poids moteurs nécessaires pour entraîner quatre mécanismes.
En y regardant de près, on voit que les systèmes de tirage des marteaux de cloches sont très fins. Ce sont des boucles métalliques de 3 mm insérées sur un axe, actionnant de petits marteaux d’un kg ou deux maximum, prévus pour des petites cloches (¼, ½, heure). Les sonneries convenaient pour un espace limité : château, monastère, ensemble administratif, …mais pas pour annoncer l’heure à travers la campagne. D’ailleurs les cloches de Villars le sec, toujours manœuvrées manuellement, sont de taille bien proportionnée.
L’église fut agrandie en 1865. Pourquoi a-t-il été décidé de changer l’horloge en fer, vieille de seulement trente six ans, s’il y en a eu une entre 1829 et 1865, sachant qu’une horloge en fer fonctionne au moins un siècle (exemple 170 ans à Béthoncourt)? Un serrurier suisse aurait monté l’horloge en 1865, mais il n’est pas dit qu’il a vendu celle-ci. Certaines pièces au niveau du clocher ne correspondent pas au style de l’horloge : les aiguilles des cadrans ne sont pas adaptées à son mécanisme, elles sont faites de métal avec masselotte de plomb et grossièrement travaillées, au lieu d’être ouvragées comme le reste de l’horloge. Ainsi que la tige du balancier qui est visiblement de l’époque du remontage de l’horloge. Peut être que lors du démontage rapide du mécanisme et dans la précipitation, les aiguilles d’origine du cadran étant inaccessibles. Les a-t-on laissées sur place ? Le support en bois n’est pas de bel aspect comme on pourrait s’y attendre vu la qualité du matériel supporté.
Il y a un seul mécanisme pour faire fonctionner les deux aiguilles, lui aussi tout en laiton et de même facture que l’horloge. Lors du démontage, les raccords de transmission sont constitués d’un tube de fer pour les minutes, serti sur le laiton, et d’une tige de fer traversant le tube pour les heures, et en direction du cadran. Ce mécanisme était en avance pour l’époque, la plupart des cadrans monumentaux n’ayant en effet qu’une aiguille. Les cadrans à deux aiguilles (aiguille à quarts), apparus en France vers 1700, étaient réservés pour les édifices prestigieux. Il se montait encore jusqu’en 1900 des cadrans à une aiguille.
Ce montage a été adapté à l’épaisseur des murs de l’église. Le cadran est en tôle avec des chiffres peints, dont on ne voit que quelques traces, ainsi que la tige et le tube, probablement de 1865.
Généralement, les horloges d’édifices possèdent un cadran interne de réglage de l’heure sur le bâti de l’horloge elle-même avec, soit deux aiguilles, soit une aiguille ou une roue tournante et un index fixe servant au réglage des minutes. Là, rien de tel. Ce qui laisse supposer qu’à l’origine, une disposition ou un lieu spécial très accessible abritait le mécanisme, un système à crans et une languette que l’on soulevait pour la remise à l’heure.
A l’emplacement de l’horloge dans l’église, on ne pouvait régler l'heure qu'à deux personnes avec une référence solaire. Après un examen soigneux de la face sud, on ne relève aucune trace visible de méridienne, ni de cadran solaire. L’heure locale faisait pourtant foi à cette époque.
Le système d’engrenage avec des pignons lanternes a perduré jusqu’en 1800 environ. Donc cette horloge daterait d’avant 1800. Cependant des pignons lanternes ont pu être fabriqués encore après cette date, le temps que les horlogers s’équipent de tailleuses. Tout le mécanisme est fait main. Les roues dentées l’ont été sûrement à l’aide d’une « plate forme » inventée vers 1700, appareil fixé sur le même axe que la roue à tailler, et les dents tracées et sculptées au ciseau et à la lime. Les pieds sont tournés et les barres de laiton semblent coulées et usinées. Il y avait des machines pour exécuter cette opération à l’époque, genre étau-limeur.
Même après la Révolution, beaucoup de biens des nobles furent vendus ou ont disparu.
Exemple : la famille du duc d’Orléans a été bannie de France en 1852 et ses biens confisqués et vendus, sous l’ordre de Louis Napoléon Bonaparte.
Il serait intéressant de connaître le cheminement de cette mécanique, savoir comment elle a pu arriver dans le Territoire de Belfort à Villars le Sec. La commune fait des recherches à ce sujet, et va demander son classement à l’inventaire des monuments historiques. La mairie de Villars le Sec ne peut assumer la garde de cette œuvre d’art (locaux adaptés, frais d’armoire sécurisée, télésurveillances). Aussi sera-t-elle confiée aux bons soins du musée Japy à Boncourt.
Nous remercions Monsieur Cousin, le conservateur en chef des musées de BELFORT, pour sa collaboration.
Nous remercions Monsieur Yves Gaume, maire d’Essert et tout le conseil municipal de nous avoir permis d’exposer au public ces précieuses horloges du Territoire de Belfort et du pays Franc-comtois
Gérard Guilbaud
Nota : Les références de dates, de mécanismes citées sont extraites de l’ouvrage de Alfred Ungerer, Les Horloges d’Édifice, janvier 1926.
Etat de l’horloge avant restauration
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Face avant
Vue arrière avec la transmission directe au cadran
L’horloge après la restauration
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Les cloches
.jpg)